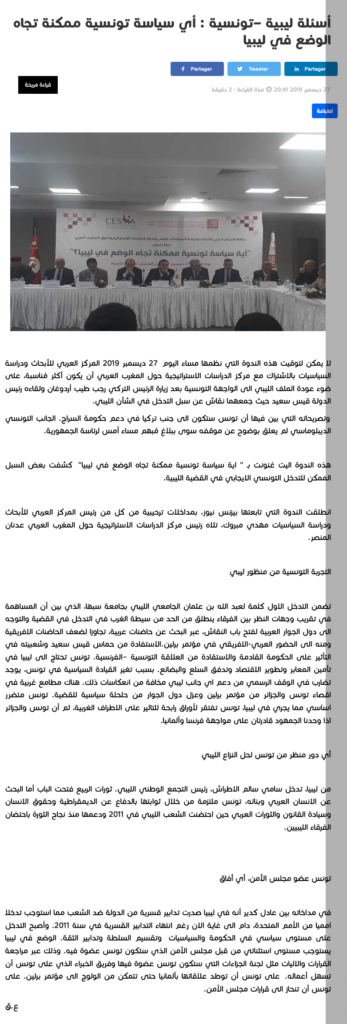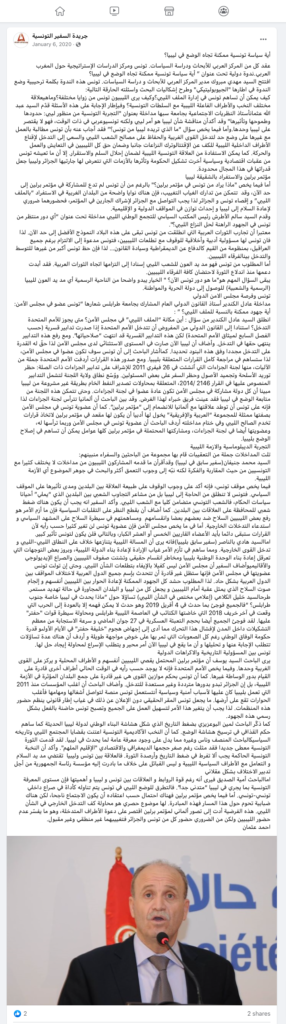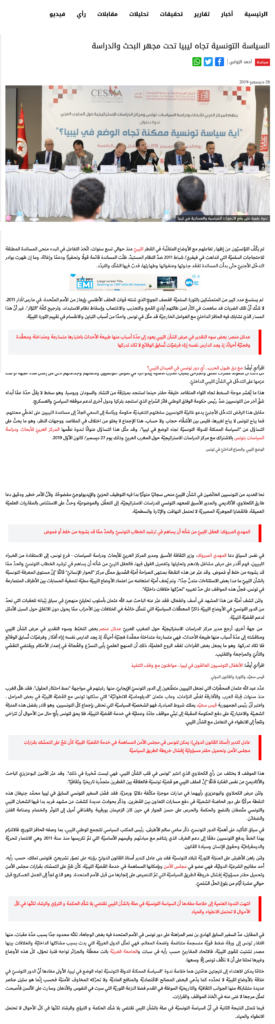Il est connu de tous que l’instabilité en Libye a eu un impact majeur sur la situation intérieure de la Tunisie. Il reste pourtant nécessaire de rappeler les données de base qui expliquent ce fait, dont la plus importante, très probablement, est la relation stratégique entre les deux pays: la structure sociale transfrontalière, la mémoire de la solidarité en temps de crise, que ce soit sous l’occupation ou dans le contexte de la tourmente associée au changement de régime, la réalité du commerce inter-régulier et irrégulier à travers le temps, ainsi que des liens culturels profondément enracinés. Alors que nous nous préparions à organiser ce colloque, le commandant en chef des forces armées, maréchal Haftar, a annoncé, pour la quatrième fois, «l’heure H» d’une opération militaire visant à nouveau le contrôle de la capitale libyenne, Tripoli. Ce n’est pas la première annonce de la «bataille finale» et ce n’est peut-être pas la dernière. En revanche, les forces armées du gouvernement de l’Accord national ont annoncé qu’elles avaient répondu à toutes les tentatives d’incursion depuis mai dernier. Cela se produit alors qu’un certain nombre de puissances occidentales préparent la «Conférence sur la Libye» à Berlin. Cependant, il semble y avoir des difficultés imminentes concernant cet événement après une escalade verbale mutuelle qui s’est produite il y a quelques semaines ; les assistants du maréchal Haftar affirmant qu’ils ne sont pas intéressés par une sortie conciliante et que la seule résolution de ce conflit doit être militaire.
Le déroulement de la « conférence sur la Libye à Berlin » semble également commencer à fléchir sur un fond d’un nouvel accord par le gouvernement d’accord national avec Ankara sur les « nouvelles frontières maritimes », qui a conduit à une escalade verbale allant au-delà de la Libye vers d’autres parties méditerranéennes, dont la Grèce et Egypte. Cet accord surprenant reflète les multiples dimensions de la «question libyenne». Il s’agit d’un conflit entièrement dominé par des parties étrangères étroitement liées, non seulement politiquement et diplomatiquement, mais aussi militairement. Ainsi, à seulement 170 km environ de la frontière tunisienne, il y a une guerre complexe d’un genre nouveau et dont la date de fin reste inconnue. Cela se produit alors que la Tunisie est dans un état de transition politique, et malgré la relative stabilité obtenue grâce à l’élection d’un nouveau président, le nouveau gouvernement n’est pas encore formé, et la question n’est pas réglée en ce qui concerne la composition qui devra directement traiter de l’affaire libyenne, qu’il s’agisse des ministères des affaires étrangères, de la défense ou de l’intérieur.
Malgré la position officielle admettant que le gouvernement d’accord national est le gouvernement internationalement reconnu, il faut noter qu’au cours des dernières années, il est apparu en Tunisie une tendance à considérer l’affaire libyenne comme un « problème de sécurité », coïncidant notamment avec le déclin de la présence diplomatique tunisienne à Tripoli et à Benghazi. Mais avec un nouveau président qui semble vouloir laisser une trace historique, et avec la Tunisie devenant membre du Conseil de sécurité de l’ONU, il est légitime de se demander: la politique étrangère tunisienne devrait-elle redéfinir la priorité des aspects politico-diplomatiques sur les aspects sécuritaires? ? La Tunisie peut-elle rester un acteur «passif» qui se contente d’offrir un havre pour les parties en conflit et une «terre de transit» pour la diplomatie des autres?
Une Libye en crise signifie inévitablement aussi une Tunisie en grande difficulté. Sur cette base, la question n’est pas de savoir s’il y a un besoin d’une politique tunisienne intensive dirigée vers la Libye, mais de quelle politique tunisienne à mener face à la situation en Libye.
Dans ce colloque, organisé conjointement par le « Centre d’études stratégiques sur le Maghreb » et le « Centre arabe de recherche et d’études politiques », nous essaierons d’envisager ce qu’est la politique tunisienne de manière innovante, principalement à travers une grille de lecture libyenne. Comment les Libyens de différents horizons voient-ils la politique tunisienne dans le contexte actuel? Comment la performance diplomatique tunisienne à l’égard de la situation en Libye a-t-elle évolué et qu’est-ce qui a prévalu, ces dernières années, dans le traitement de la sécurité sur d’autres préoccupations envers le voisin du sud? Que perdrait la Tunisie et que gagnerait-elle si elle maintenait ou modifiait sa gestion actuelle de la situation en Libye?